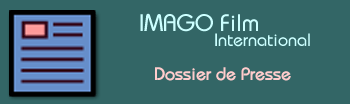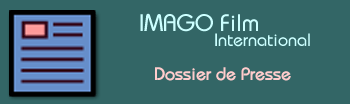| | Si Moh | El Chergui | 44 récits | Caftan | Cinéma égyptien | La Dame | Matisse | Chroniques | Le Gosse de Tanger Si Moh Pas-de-Chance.
(Si moh la hadha lak)
Scénario, réalisation, production: Moumen Smihi
Images: Colin Mounier
Son et musique: Gérard Delassus
Montage: Claude Farny
Interprétation: Abdeslam Sakini
Production: G.R.E.C/C.N.C Paris
Format: 16 mm
Durée: l7 mn
Date: 197O
N & B.
Comme l'appel du muezzin, un chant d'oiseaux imaginaires domine le fracas de la ville; écroulé au seuil d'une bouche de métro, au soir d'une autre journée d'exil, Si Moh regarde des cartes postales de son pays, le Maroc.
Il s'agit de la dernière séquence du Grand Prix du Court Métrage au Troisième Festival International d'Expression Française de Dinard, décerné à l'unanimité à Moumen Smihi, 26 ans, né à Tanger. Nous venons de vivre dix-sept minutes haletantes ou plutôt, selon Smihi, "des kilomètres de secondes à la recherche de la mort exacte".
En 1967, Moumen Smihi obtient son diplôme de l'I.D.H.E.C. Alain Resnais le branche sur Chris Marker qui, par l'intermédiaire de Marie-Jo Corajoud, l'introduit auprès du Centre National de la Cinématographie, lequel, en, 1969, a fondé le Groupe de Recherches et d'Essais Cinématographiques.
Sur présentation du synopsis, un des trois collèges décide d'allouer les 7.OOO F permettant de réaliser Si Moh avec des acteurs non-professionnels.
On ne raconte pas Si Moh, un film-poème, toujours au bord du vertige, dont la facture rigoureuse sous-tend l'implacabilité de la tragédie quasi muette vécue par un homme qui marche dans une ville comme un somnambule.
| | Jane Rouch
Jeune Afrique
27-7- 71
Paris. | "Si Moh", court-métrage couronné par le jury à l'unanimité, est un petit chef-d'oeuvre d'intelligence et de tact, sur un sujet où tant de cinéastes chevronnés se sont rendus coupables de platitudes ou de clichés. Il s'agit du journal intime d'un ouvrier marocain, venu chercher du travail à Paris, et confronté avec l'hostilité du milieu d'accueil.
Beaucoup plus féroce par sa discrétion, la satire de Smihi emprunte des chemins poétiques inattendus, pour traiter d'un problème déjà évoqué dans des longs-métrages.
Mais l'originalité de ce jeune cinéaste marocain, c'est de posséder outre le sens de la construction, celui de l'écriture filmique. "Si Moh" est la démonstration éclatante de la nécessité du court-métrage dans la naissance d'une carrière de cinéaste. Arriver à une telle maîtrise d'expression avec des moyens aussi limités, force notre admiration. Smihi n'a que vingt-six ans: il lui reste une vie remplie de promesses, et beaucoup de choses à dire.
| | Henri Chapier
Combat
12-7-71
Paris. |
Le grand prix du court métrage est allé à "Si Moh". Sur un thème qui était déjà celui de "Mektoub" (un Nord-Africain erre dans Paris à la recherche d'un emploi), l'auteur a composé une suite de tableaux baignés de grisaille, dont la sensibilité et la pudeur sont exemplaires. La vie quotidienne du travailleur exilé paraît d'autant plus accablante que l'émotion est continuellement transcendée. On décèle chez Moumen Smihi, qui est encore très jeune, un vrai tempérament de cinéaste.
| | Jean de Baroncelli
Le Monde
15-7-1971
Paris. | 
El Chergui, ou Le silence violent.
(riyah charkiya aw al samt al anif)
Scénario, réalisation et production: Moumen Smihi
Images: Mohammed Sekkat
Son: Gérard Delassus
Montage: Claude Farny
Interprétation: Leïla Shenna, Abdelkader Motaa
Production: Aliph Films-Rabat, Mohammed Torres-Casablanca, Mohammed Tazi-Tanger
Format: 16 mm et 35 mm
Durée: 85 mn
Date: 1975
N & B.
Tanger, 1954: lieu et date ont leur importance. En ce temps-là, Tanger est encore une concession internationale. Le sultan Mohammed Ben Youssef, déposé par les Français, vit en exil, et, sur le trône chérifien, siège Ben Arafa, le fantoche imposé par Paris. En ce lieu (Tanger), à cette date (1954), les Marocains sont doublement dépossédés d'eux-mêmes. Dans tous les domaines, politique, économique, culturel, social. Ils ne s'appartiennent pas. Et ce sont d'abord les signes de cette dépossession de soi-même que Moumen Smihi multiplie, en accumulant les notations brèves grâce à un montage impressionniste: drapeaux étrangers, architectures européennes, circulation européenne, langages européens, l'espagnol et le français, à tous les coins de rue, sur des plaques, sur tous les magasins, jusque dans l'air qu'on respire, sur les ondes des radios.
C'est une fois posé ce cadre, précisé ce contexte, que se déroule le drame individuel conté par Smihi. Toujours par touches, nettement détachées par le montage, il glisse de la description de la ville étrangère à l'évocation de la ville indigène, existant en marge de la ville étrangère, sous elle. A l'intérieur de l'un des quartiers indigènes, nouvelle glissade centripète vers le portrait d'une famille, la famille d'Aïcha, belle-mère, mari, fils. Enfin, voici Aïcha. A l'instar de la buse guettant son gibier, Smihi procède par cercles concentriques et de plus en plus étroits pour capter le personnage central de son film. Approche faussement lente que cette démarche circulaire, dessinant une sorte de volute préliminaire. Et dont aucun détail n'est superflu.
Pour bien comprendre le drame à venir, qui est d'abord le drame d'Aïcha, femme, épouse, et mère au milieu du vingtième siècle, dans le Maroc "protégé" par la France, il nous faut bien voir ce qu'était la vie quotidienne dans ce Maroc-là, à ce moment-là de son histoire, et la place qu'y pouvait occuper Aïcha. Tableau d'une précision à la fois minutieuse et pourtant discrète.
Prières, ablutions, école coranique: forte présence de la religion; forte présence des voisins; forte présence, autour de la famille, d'une certaine misère économique, évoquée à travers l'existence d'un jeûne chômeur traînant ses babouches et son ennui dans les rues ou sur la plage; vigoureuse prééminence de l'homme sur la femme ("phallocratie", en style d'aujourd'hui), conduisant les femmes, à l'intérieur de la famille, à s'organiser en un petit monde reclus et solitaire pour résister sournoisement à l'oppression masculine. Servitude et revanches d'alcôve. Ce drame de la femme marocaine, Smihi l'illustre par le récit de sa vie au jeune chômeur (femmes traitées comme du bétail qui s'est échappé de l'étable et qu'on ramène manu militari); il l'illustre surtout par l'histoire d'Aïcha.
Histoire banale. Le mari prend une seconde épouse, plus jeune bien sûr, que la première, qui est Aïcha. Autour d'Aïcha, résistance des femmes, celles de la famille plus les voisines alliées. Résistance qui ne peut-être que clandestine. Elle s'appuie sur des recettes mêlant la magie et la cuisine, la religion et la pharmacie, en un large déploiement secret de cataplasmes et de massages, de sacrifices et de fumigations, bref: de "flouss" et de maraboutisme. Au coeur de la résistance, en son centre, se dresse}
Aïcha, belle et grave, bloc sombre, murée dans un long cri muet- Leïla Shenna, comédienne marocaine déjà remarquée dans "Remparts d'argile" et dans "Chronique des années de braise", est ici magnifique.
Le film se construit le long de la lutte clandestine d'Aïcha: mais Smihi refuse le dessin linéaire du récit romanesque à l'occidentale. L'aspect impressionniste de son style, le recours aux séquences éclatées lui permettent d'enlacer à l'histoire centrale des histoires connexes (le chômeur, la putain) complétant la signification de l'histoire centrale. Le montage, d'une mobilité aussi sensible que fluide, l'intelligente utilisation de la bande sonore nouent très habilement les deux thèmes: aliénation de la ville (et de la nation marocaine), aliénation de la femme (qui n'est pas seulement d'ordre conjugal mais que reconduisent sorcellerie et maraboutisme, sur quoi Smihi pose un regard sans doute compréhensif quoique sans complaisance).
La déambulation morose d'Aïcha à travers la ville, en quête de moyens propres à armer sa résistance et, peut-être, à assurer son salut, n'est jamais promenade pittoresque, intermède joliment touristico-folklorique. C'est tout le contraire: l'exploration pensive d'une condition assujettie. A la blessure de la femme correspond la blessure coloniale. Aïcha, les yeux dessillés par son malheur, découvre le malheur de la ville (et nous le découvrons avec elle). Lente prise de conscience: la servitude et les maîtres, là les Européens, ici son mari. Au silence violent d'Aïcha répond le silence violent de la ville, d'abord fait des bruits étrangers, cloches chrétiennes, sirènes des usines et du port, paroles étrangères- puis fait du vrai silence de la grève, des rues vides, de la ville morte. Et, quand Aïcha, recrue de tristesse, éclate en sanglots, elle ne pleure plus seulement sur son propre sort.
Sanglots de la résignation? En pleine rue, Aïcha, en proie à une brève flambée de révolte, risque un geste lourd de sens pour une
musulmane: elle arrache le voile qui lui couvre la bouche. Geste qui
l'expose au scandale et par lequel elle s'expose, par bravade, au désir
d'un mendiant. Parallèlement, ou plutôt conjointement, la ville, par une manifestation mêlant la superstition populaire, le mysticisme et la vénération monarchique, expose sa foi envers le souverain exilé, s'abandonne à l'émeute, s'expose à la répression (que Smihi évoque en insérant à la trame de son film des extraits d'actualités).
Le film ne s'arrête pas avec le dénouement navrant de la mort d'Aïcha. La vie continue. Ce qui, à Tanger, en 1954, signifie: les drapeaux étrangers, les troupes dociles de la main-d'oeuvre autochtone à très bon marché, le chômage des jeunes et le recours à la consolation du kif, et, dans la rade, l'énorme masse du paquebot immobile, bouchant l'horizon. Le fils d'Aïcha est à l'école. Il apprend le français. Mais Smihi fait écrire sur le tableau noir par le maître et lire par le gosse, avec le choeur des gamins de son âge et l'application réservée à la psalmodie du Coran, trois mots terribles et comme annonciateurs d'un futur menaçant: feu, flamme, fou.
Quand, à Tanger, capitale des vents, souffle le vent d'est, el chergui, les montagnards de l'Atlas disent que ce vent est mauvais pour les femmes malheureuses en ménage. Ce vent, on l'entend souffler, dans le film. Mauvais, il ne l'est pas que pour Aïcha.
| | Jean-Louis Bory
Le Nouvel Observateur
6 janvier 1976 Paris. | 
44 ou Les récits de la nuit.
(44 aw Oustourat al layl)
Scénario, réalisation et production: Moumen Smihi
Dialogues: Mohammed Bennis, Moumen Smihi
Images: Pierre Lhomme, Abdelkrim Derkaoui
Son: Studio Aïn Chok-Casablanca
Montage: Claude Farny, Elizabeth Moulinier
Musique: Benjamin Yarmolinsky et Guido Baggiani
Recherche sur les décors: Farid Belkahia, Patrice de Mazières
Costumes: Driss Raïss El Fanni
Interprétation: Abdeslam Faraoui, Marie-France Pisier, Pierre Clementi, Naïma El Mcharki, Christine Pascal, Mohamed Habachi
Sous-titres français: Pascal Kané
Production: S.M.D.C / B.C.M-Casablanca, Filmodie-Paris, Imago Film International-Tanger
Format: 35 mm
Durée: 11O mn
Date: 1981-1985
Couleur
Il me faut de prime abord avertir le lecteur: les propos qui vont suivre ne seront que la transcription malhabile et prétendument objective d'une passion subite, fatale et donc définitive: je suis tombé éperdument amoureux de "44 ou Les récits de la nuit", film de Moumen Smihi. A mon âge, celui du démon de midi, la chose est sans remède. Qu'on ne vienne donc pas me représenter que le sens commun ou je ne sais quelle prudence commande plus de modération dans mes jugements- ou que l'amour est aveugle: de naissance je suis un amoureux lucide, et j'ai tendance à croire que tous les sages qui gravitent dans mon orbe sont frappés de cécité lorsqu'ils ne discernent pas comme moi les charmes de l'objet aimé.
Ceci dit, essayons d'aborder, à propos de cet objet, la dissertation pesante, étayée d'arguments, qui est celle que l'on attend du critique. Réduit à son intrigue, un film comme "El Chergui", le premier film de Moumen Smihi, pouvait ne figurer qu'un drame à l'égyptienne: une épouse, dont les charmes ont cessé d'agir sur son mari, se suicide lorsque ce dernier, sans la répudier, se remarie.
Si l'on s'en tient encore à la tyrannie de l'intrigue, "44 ou Les récits de la nuit" aurait pu donner lieu à une de ces sagas dont les Américains ont le secret: je songe à "Géant" ou à "Autant en emporte le vent", où le Temps brasse et broie personnages et générations pour peindre les douloureuses transformations d'une nation en marche.
Il s'agit ici de l'histoire d'une famille fassie à travers l'Histoire récente, celle des quarante quatre années où le Maroc subit la tutelle des Français et des Espagnols. Le père est professeur à l'université Karaouiyine- un bourgeois donc, mais non un marchand. Son épouse accepte malgré elle la présence d'une seconde femme, plus jeune et plus belle, ce qui, pour les enfants, est l'occasion d'un de ces traumatismes que le temps finira par recouvrir sans l'absorber totalement. Le père donne pour précepteur à ses enfants l'un de ses meilleurs étudiants, Moussa, jeune homme très pur et très pauvre, originaire de Chaouen. Moussa se passionne pour le théâtre: il interprète avec ses camarades l'Othello de Shakespeare, en langue arabe. A l'issue de la représentation, au moments des applaudissements, les acteurs entonnent un chant nationaliste qui soulève les foudres des autorités françaises alors en place: ils devront cesser leurs études et s'exiler, sauf Moussa, lequel, dans la décomposition des dernières années du protectorat, finira mendiant.
Pendant ce temps, le fils aîné de son ancien professeur ira poursuivre ses études en France. La soeur de ce dernier, elle, se contentera de se marier. Le père, au seuil de la mort, exige d'être enseveli sans cercueil- dernière résistance contre les moeurs de l'occupant: sa seconde épouse, méditant sur les travaux de son mari défunt, va prendre la relève: elle travaillera dans la cité à l'alphabétisation des femmes.
Comme on le voit, l'argument de ce film est beaucoup plus volumineux que celui de "El Chergui". Le temps est celui du protectorat- ces quarante quatre années où deux cultures, deux conceptions de la vie et du temps vont, comme deux planètes, entrer en collision. N'empêche: le traitement de l'auteur, ressemble, sur bien des points, à celui de son film précédent, avec son récit à peu près ravalé au rang d'anecdote, brisé constamment par des références historiques à la résistance dans le Rif, dans l'Atlas et dans le Sud. Rupture, donc, de la linéarité narrative, écartèlement du temps et de l'espace- ce qui abolit la notion traditionnelle de séquence, réplique cinématographique du chapitre de roman.
En fait l'argument de "El Chergui", de "44", pouvaient donner lieu à un développement de type linéaire, relevant de la conception du temps qui a fait le bonheur du roman européen et du cinéma héritier dans une très large mesure de ce roman: chez Balzac, comme chez les soeurs Bront\'91 ou chez Tolstoï, il s'agit d'un temps chronologique, c'est-à-dire d'un temps où la durée subjective, l'expérience vécue sont récupérées par la logique, surtout si cette logique est celle de l'Histoire. La preuve, c'est le détail du chapitre, où chaque moment en entraîne un autre, si bien que toute action s'insère dans l'engrenage causal dont Racine, au dix-septième siècle, a été le champion. Dans cette conception du Temps, l'Histoire tient lieu de destin, qu'il s'agisse d'une optique biblique ou d'une optique marxiste.
Il en va tout autrement du Temps chez Moumen Smihi: son écriture récuse le temps des affaires aussi bien que le temps positif. Et ceci pour une raison majeure: le temps de quarante quatre années de Protectorat est un temps éclaté, consécutif à la collision dont je parlais tout à l'heure. La chronologie, rappelée sur l'écran par une série d'encadrés qui traduisent les analyses de l'envahisseur, n'est là que comme une politesse élémentaire consentie à l'historien. Il fallait bien mentionner l'Histoire pour plonger dans les profondeurs qui la dépassent. Donc à l'Histoire éclatée du fait du heurt de deux cultures dont l'une risque d'être mortelle pour l'autre, répond un Temps éclaté. A temps éclaté, écriture éclatée.
Après tout, la lutte du Maroc contre l'envahisseur pourrait être ramenée à celle d'une chevalerie contre un appareil militaire relevant d'une Europe mécanisée, cuirassée par ces machines que sont les chars d'assaut et les avions. Pour l'écriture, donc: ni épopée propre à traduire cette chevalerie désarçonnée, démantibulée, explosée, ni romanesque réverbérant le temps et ses engrenages.
C'est là que, précisément, le temps de l'articulation romanesque, qui ressemble comme un frère à celui des affaires (Time is money) ou à celui de la récupération du marxisme positif cède le pas à la vision des profondeurs. Lorsque Moumen Smihi se penche sur ce Maroc abîmé au fond des flots, il le fait avec l'amour d'un archéologue ouvrant la sépulture où Pharaon, à l'abri du temps, a continué de vivre une existence immémoriale au fond des siècles.
Le Maroc de Moumen Smihi semble peu à peu se libérer de l'Histoire qui l'a produit, pour resplendir librement dans son éternité, dans son absolu. Comme le Parthénon de la Grèce antique, comme le Taj Mahal de l'Inde ancienne, comme les pyramides de l'Empire inca, Fez dresse ses murailles, les ruelles de Chaouen se creusent d'ombres ou se remplissent de poussière éternelle, avec les hommes d'antan, ces spectres éternellement là, au-dessus du devenir, semblables à d'immortels jalons sur cette voie problématique que l'on appelle civilisation et propres à servir de repères à ces naufragés de l'Histoire que l'on appelle les hommes.
Il n'y a pas l'ombre d'un pittoresque dans ce film qui est moins destiné au touriste que n'importe quel autre. Religieusement ses personnages se penchent sur des reliques qui ne deviennent telles que lorsque le Temps a balayé les années: si la caméra évoque une circoncision, ce n'est jamais dans une optique documentaire. C'est que le jeune héros, de retour de France où il poursuit ses études, restitue subjectivement ce traumatisme qui a fait de lui un musulman à part entière dans ses jeunes années. Si c'est le rituel du henné lors des fiançailles de sa soeur, c'est toujours dans la même perspective de la reviviscence nostalgique.
Ces batailles, ces murailles, ces êtres peu à peu broyés par l'Histoire accèdent peu à peu à la légende, et l'auteur leur rend, grâce à l'écriture, leur dimension d'archétype. Comment ne pas être sensible à cette démarche? Mizogushi, Kurosawa, les deux plus grands réalisateurs japonais, ont suivi la même voie: devant l'agression mécanique, devant l'américanisation de leur patrie, ils ont signé des films où revit le Japon rituel- le Japon sacré. Ces films se nomment "Contes de la lune vague après la pluie", "Les amants crucifiés" ou "Les sept samouraïs" pour ne citer que quelques titres. Cela aussi s'appelle résister. Résister et respirer.
Un mot sur la fin de notre film. L'auteur ne nous livre pas la liesse de l'Indépendance. Sa piété évite le fracas des applaudissements. La simple vision d'un drapeau marocain lui suffit. Ici, l'absence de triomphalisme est une option philosophique et esthétique.
Pour finir- cet étudiant qui potasse ses révisions en vue de l'examen: il arpente le sable au bord des vagues. Il répète, mécaniquement, en français: "Nouvelle Politique \'83conomique, la N.E.P...Comparons l'économie américaine et l'économie soviétique...". Critique implicite: l'aliénation dont nous venons de vivre les différentes phases se poursuit. Cet étudiant est de ceux d'aujourd'hui- condamné au par-coeur plutôt qu'au choix intelligent. Un emmuré, victime comme son pays des partages de Yalta.
C'est alors que ses yeux se détachent de la page qu'il ânonne et se posent sur l'horizon. Ses yeux interrogent l'océan, l'avenir, comme ceux de tout jeune marocain: "Que fait-il là? Où va-t-il? Où va ce monde?...".
| | Jean-Pierre Millecam
Lamalif
mai/juin 1983
Casablanca. |

Caftan d'amour constellé de passion
(Qouftan al houb mounaqat bil hawa)
Scénario: Gavin Lambert et Moumen Smihi
D'après "The Big Mirror" de Mohamed M'rabet et Paul Bowles
Dialogues: Mohamed M'rabet, Jacques Fieschi
Dialogues, réalisation et production: Moumen Smihi
Assistant-réalisateur: Bertrand Jenny
Images: Jean-Michel Humeau
Son: Jean-Louis Richet
Costume: Khadija EL Hmam
Montage: Martine Giordano
Musique: Jorge Arriagada, L.V.Beethoven, J.S. Bach
Interprétation: Nathalie Roche, Mohamed Mehdi, Larbi Doghmi, Nezha Regragui
Sous-titres français: Claude Thomas
Production: La Sept/Arte-Paris, Ciné Magma-Paris, Imago Film International-Tanger
Format: 35 mm
Durée: 9O mn
Date: 1988
Couleur
Parmi les événements de la rentrée culturelle cette année au Maroc, la sortie du nouveau film de Moumen Smihi, "Caftan d'amour". C'est un événement par rapport à la situation générale de la production cinématographique marocaine qui a connu ces dernières années une stagnation complète. Situation qui n'est pas sans influencer l'accueil réservé à une nouvelle réalisation, car les réactions témoignent du refoulé engendré par la longue attente de la naissance d'un cinéma national, ce cinéma tant désiré dans les débats des ciné-clubs des années soixante et soixante-dix.
Le fait est qu'avec le nouveau film de Moumen Smihi, il est possible de parler de la fin d'une période et du début de la recherche d'une nouvelle.
Moumen Smihi (né à Tanger en 1945) est un remarquable metteur en scène. Il est considéré comme l'un des précurseurs du courant intellectuel dans le cinéma maghrébin, à côté de Bouanani et de Derkaoui. La critique locale désigne comme intellectuels les metteurs en scène du Maghreb qui refusent tout à la fois le cinéma hollywoodien et oriental du Caire, de Bombay ou de Hong-Kong.
Le film de Moumen Smihi "El Chergui" avait été le porte drapeau de ce courant. Il avait constitué un manifeste de l'écriture cinématographique, une écriture qui rejette le cinéma dominant et cherche à s'éloigner de la tradition du film à grand public, en détruisant la structure narrative traditionnelle, en dépassant la notion de l'acteur-star, en ignorant l'intrigue, pilier de la dramaturgie classique.
En plus de cette obsession du travail de la forme, "El Chergui" était apparu comme préoccupé par une interrogation de type anthropologique liée à un espace, un temps et un corps déterminés. Il avait choisi la ville de Tanger comme l'espace propre à dérouler le temps de la colonisation, et le corps de la femme comme métaphore, comme trace de la culturalité.
Dans le parcours cinématographique de Moumen Smihi, "44 ou Les récits de la nuit" fut la seconde étape. C'était une coproduction Maroc-France (1982). Avec ce film, Smihi a entamé le début d'une évolution qui se confirme avec "Caftan d'amour". La recherche formaliste n'occupe plus que le second plan, laissant le premier au questionnement portant sur la mémoire, sur l'Histoire telle qu'elle se déroule sur une ligne verticale partant de 1912 ( début de la colonisation ) jusqu'à 1956 ( l'année de l'Indépendance ).
Ce film est en couleurs et sollicite des acteurs-vedettes français et marocains pour renforcer le travail de la mise en scène.
Après cette réalisation, Moumen Smihi a tenté une nouvelle expérience qui a demandé plusieurs années de souffrances, les souffrances du metteur en scène au Maroc pour trouver un financement. Dans l'absence d'une industrie du cinéma aux branches, aux rôles et aux fonctions bien dessinés, il incombe au seul personnage du réalisateur d'assumer toutes les "casquettes", depuis celle du scénariste jusqu'à celle du distributeur, en passant par la production et la réalisation.
Après plusieurs années de recherche de financement et de préparation, Moumen Smihi a pu finalement présenter son troisième long métrage au publique marocain au début du mois d'octobre dernier.
La production du film est double, marocaine et française.
La dualité est peut-être l'une des clefs qui permettent l'accès à ce film. Dualité de la production donc, mais aussi dualité de la construction dramatique, car la narration s'articule sur les deux axes du rêve et du réel. De plus Rachida, l'héroïne, est dotée d'une double personnalité. Enfin le déchirement que vit le héros, Khalil, s'origine dans une dualité permanente: celle de la langue ( arabe/français), du mode de vie (ville/campagne), etc. La plongée dans les profondeurs de ce dualisme ontologique constitue la base du discours et des idées du film.
Le film s'ouvre par la séquence du rêve. Nous faisons connaissance avec le personnage principal: Khalil, un jeune homme qui exploite une ferme familiale dans les environs de la ville (Tanger), cherche la femme de sa vie. Il la voit dans son rêve: une jeune fille d'une beauté exceptionnelle. Il décide de l'épouser.
Par hasard, dans les ruelles de la médina, il rencontre la fille de son rêve. Elle s'appelle Rachida. En l'épousant, il n'abolit pas le rêve. Le rêve au contraire évolue et se transforme en cauchemar, car Rachida, en plus de son exceptionnelle beauté, a un comportement exceptionnel. Elle souffre de ce que les femmes de Tanger nomment la "maladie de la beauté", c'est-à-dire, en termes de médecine moderne, d'une double personnalité, d'une schize. Elle ne cesse de parler à son miroir et de ce fait s'éloigne du réel, éloignant du même coup Khalil de son rêve et le précipitant dans un cercle infernal où se fondent et se confondent rêve et réalité.
La première séquence semble résumer et contenir tout le film. Au coeur de son rêve, le héros se rend compte qu'il se trouve entre la ville et la mer. C'est le dialogue du Je et de l'Autre, l'affrontement entre l'Etre et le Monde. La jeune fille dans l'eau souligne le flux et reflux de
cet antagonisme. Elle est à moitié nue, et porte des effets de bain moitié traditionnels moitié européens. Un vieux couple habillé
traditionnellement a pris place à l'entrée d'une case.
Le montage de cette séquence nous communique l'impression que nous sommes face à un choc des cultures, souligné par l'espace, Tanger, cette ville cosmopolite. Tanger, produit du choc des cultures, et Khalil, enfant de Tanger, un héros tragique, produit de la déchirure culturelle.
Son aller retour perpétuel entre le rêve et la réalité, ou l'inverse, personnifie la douloureuse recherche d'une identité. Cette identité qui impose de choisir à tout instant: choix d'un espace où vivre, choix d'une langue pour communiquer, ou même le simple choix d'une boisson.
Mais Khalil a-t-il réellement la liberté du choix?
Sur le plan du discours, Moumen Smihi reste donc fidéle à ses obsessions premières avec toutes leurs ramifications. Ce sont des obsessions qui portent sur des thèmes, des interrogations et des questionnements propres à constituer des corpus de recherches universitaires. On reconnaît à l'auteur, dans le cinéma arabe, son intérêt pour les sujets épineux. On lui reconnaît son exploitation de systèmes de pensée ambitieux ainsi que son talent dans les compositions esthétiques. L'option est claire: faire du cinéma un outil pour traiter des grandes questions de la pensée. Mais on pourrait dire que le film est trop chargé par ce souci d'intellectualisme, ce qui a défavorablement déteint sur la construction dramatique, surtout en son milieu qui souffre de répétitions, et engendre l'ennui alors que l'action atteint à son paroxysme (Rachida tue son enfant).
Le film est remarquable par sa maîtrise technique et artistique, maîtrise caractéristique des autres films de Moumen Smihi. Il est parmi nos rares metteurs en scène qui donnent au plan toute son importance, soit au niveau de sa composition, c'est-à-dire l choix du cadre, de sa lumière, des détails de couleurs ou d'accessoires qui deviennent des signes enrichissant la lecture. Le montage, le sens de la coupe servent la pensée de l'auteur.
Dans "Caftan d'amour" la maîtrise de certaines scènes atteint son point culminant, leur donnant une aura plastique de haut niveau, au point que certaines d'entre elles s'assimilent à l'exercice de style ou au clin d'oeil à de grands metteurs en scène (Fellini par exemple, dans la dernière séquence sur la plage).
Moumen Smihi avait voulu Isabelle Adjani dans le rôle de Rachida, mais diverses raisons ont fait qu'il a retenu Nathalie Roche, une Française elle aussi, qui obtient son premier grand rôle et dont elle s'en
tire honorablement. Mohamed Mehdi, qui joue Khalil, est un animateur de la radio qui travaille épisodiquement dans le cinéma. Les rôles
secondaires sont marqués par leur héritage théâtral (Larbi Doghmi, Chaibia Adraoui) à l'exception de Nezha Regragui, dans le rôle d'Aouicha, remarquable par sa présence physique et son sens de la tragédie.
Le film reçut un grand accueil des milieux intellectuels, même si parfois un peu complaisant. Il tint l'affiche pendant deux semaines consécutives dans deux grandes salles casablancaises. Il sera ensuite distribué dans d'autres villes marocaines, où l'attend l'épreuve de la fréquentation et du nombre d'entrées.
| | Mohamed Bakrim
Al Yawm Al Sabi'
2 janvier 1989
Paris. | 
Cinéma égyptien, défense et illustration.
(taqarir moujaza fi al cinima al masriya) Scénario, réalisation, production: Moumen Smihi
Images: Kamal Abdelaziz
Son: Mohamed Hasanof
Montage: Roberto Garzelli
Musique: Sayid Darwish, Mohammed Abdelwahhab
Production: Aflam Assohba- Le Caire, ADR Productions- Paris
Imago Film International- Tanger
Format: 16 mm
Durée: 52 mn
Date: Tourné en1991. Inédit
Couleur
Le cinéma égyptien reste un sujet de débat dans toute la région arabe. Débat qu'on mène avec amour ou avec un ressentiment, en y apportant soit de simples remarques techniques, soit une critique permanente. Car le cinéma égyptien est considéré comme matri ciel dans le Monde arabe.
Mais il y a encore un autre aspect des choses. En Occident, le cinéma arabe est considéré comme "oriental", ce qualificatif servant à désigner un plat appétissant mêlant le folklore à la musique et à la danse du ventre. A tel point que chaque bon film arabe est accueilli en Occident avec surprise et étonnement.
Il y a en plus la guerre des satellites qui arrive.
C'est un peu pour toutes ces raisons que le milieu cinématographique égyptien a accueilli chaleureusement le metteur en scène marocain Moumen Smihi, qui est venu au Caire tourner un documentaire sur le cinéma égyptien.
Le film se veut un reportage, ou plus exactement une enquête filmée, multipliant les rencontres avec les artistes et les responsables des différentes étapes de la fabrication d'un film, depuis l'écriture du scénario jusqu'à la distribution de vidéo-cassettes, en passant par les problèmes de la production, le choix des acteurs, la prise de vue, la censure, la distribution.
S'intitulant " Brève enquête sur le cinéma égyptien ", le film dure 52 minutes, et fut tourné en 16 mm synchrone, sur un scénario de Moumen Smihi, basé sur une étude sérieuse de l'Histoire du cinéma égyptien et de son enracinement dans la culture arabe. Le but du film est de présenter, aussi, un témoignage vivant sur les ambitions du cinéma égyptien actuel.
Moumen Smihi est un metteur en scène marocain ambitieux qui a étudié le cinéma à Paris, à la fin des années 6O. Il a commencé sa carrière par la réalisation de courts métrages. Son premier film de long métrage date de 1976 ("El Chergui"). Le deuxième de 1982 ("44 ou Les récits de la nuit"). Enfin il a réalisé "Caftan d'amour" qui a été présenté au dernier Festival du Caire.
Il travaille maintenant avec beaucoup d'enthousiasme sur ce nouveau projet, qui est une coproduction France-Egypte-Maroc. Il a en projet, en outre, la réalisation d'un long métrage, dont Bachir El Dik est en train d'écrire le scénario, et qui sera basé sur une histoire égyptienne, avec des artistes égyptiens.
Le tournage du documentaire a mené Moumen Smihi sur divers lieux importants du Caire, tels la place Talaat Harb, le quartier des
Studios de cinéma, les plateaux de cinéma, où il a tourné des scènes sur le tournage de feuilletons de la télévision, dont "Layali al hilmiya", et aussi dans les théâtres, où il a tourné une scène pendant la représentation de "Ahlan ya bakaouat", outre les lieux touristiques du Caire, tels les Pyramides, le Nil, et les monuments.
Avant de s'envoler pour Paris, où il procédera au montage de son
film, nous avons eu l'entretien suivant avec Moumen Smihi.
-Pourquoi ce film? Quel en est le but? Pourquoi le cinéma égyptien?
-Parce que le cinéma égyptien est l'un des plus importants, des plus anciens cinéma du monde.
Parce que le cinéma égyptien est la colonne vertébrale du cinéma arabe. Il a cent ans d'existence, avec une formidable accumulation dans le domaine industriel comme dans les domaines artistiques.
Nous sommes aujourd'hui à une étape décisive de l'évolution de la culture des images et des sons. Nous sommes entrés dans une sorte de "guerre des images". Partout dans le monde on produit une image de soi qui connait une diffusion planétaire, grâce aux satellites.
Les Arabes aussi sont tenus de prendre position dans ce paysage planétaire de l'image. Nous devons déterminer notre position par rapport au nouveau cinéma, par rapport au cinéma mondial. Nous devons procéder à une évaluation de notre cinéma, dont le centre en est l'Egypte, et en présenter une sorte de "fiche technique".
A travers ce film, je tente une évaluation du cinéma égyptien, et je cherche à en parler d'une façon nouvelle, sans "retouches", sans embellir la situation actuelle. Je cherche à présenter un certain nombre de témoignages, par l'image et le son, sur la situation réelle. J'ai demandé à un certain nombre de metteurs en scène, de stars de l'écran, de décideurs dans la production, la distribution ou la télévision, de répondre chacun à une question précise, et cela pour dégager une image du cinéma arabe qui soit à l'opposé de l'image stéréotypée qu'on a en Occident du cinéma égyptien.
Je n'ai pas voulu faire des entretiens avec les gens. A chacun, j'ai présenté une question précise, qui correspond à un témoignage particulier.
J'ai demandé à Youssef Chahine d'intervenir sur le concept de Producteur-Réalisateur dans l'Histoire du cinéma. On sait que ce concept est fondamental dans le cinéma américain par exemple.
A Salah Abou Seif, j'ai demandé d'évaluer le cinéma égyptien par rapport au cinéma arabe d'une part, et par rapport à la littérature arabe d'autre part, à travers son expérience de l'adaptation de Mahfouz.
J'ai été très heureux que Tewfiq Salah ait accepté mon idée de le filmer en silence, sans qu'il parle, parce qu'il n'a pas tourné depuis longtemps.
Avec Mohamed Khan, Khaïri Bishara et Bashir El Dik, j'ai pensé qu'il fallait une question complémentaire, à laquelle ils répondent, ensemble dans le cadre, successivement. Elle portait sur le destin, le futur du cinéma arabe.
La grande surprise fut pour moi la réponse de la star Adil Imam. Je lui ai demandé, en le taquinant, s'il travaillait en fonction d'une spontanéité, comme le pense d'ailleurs son public, ou bien selon une méthode, une pratique et une pensée qui se référent à l'Histoire de la comédie cinématographique, qui est passée par les étapes successives du spectacle des forains, de celui du cirque, puis du théâtre et enfin du cinéma. Sa réponse témoigne que Imam est aussi un intellectuel parfaitement au courant de l'Histoire du cinéma; la façon dont il a tracé les liens qui le lient à Al Kassar, à la tradition culturelle de la comédie égyptienne est très intéressante.
Ahmad Zaki m'a agréablement surpris aussi par son enthousiasme à dire combien le psychologique est déterminant dans l'approche du personnage qu'il va jouer.
J'ai choisi Ahmed Al Qualla comme producteur parce qu'il a produit le plus de films intéressants et surtout de la nouvelle génération. Je lui ai demandé d'intervenir sur la question du rapport entre le bon goût et le commerce.
A mon sens toutes les réponses étaient très riches d'informations et de réflexions justes sur le sujet.
| | Mouna Thabith
Akhir Sa'a
Février 1989
Le Caire. | 
La Dame du Caire
(Sayyidatu al Kahira)
Synopsis: Gavin Lambert et Moumen Smihi
Scénario: Bachir El Dik et Moumen Smihi
Dialogues: Bachir El Dik
Réalisation, production: Moumen Smihi
Images: Tarek Telemsani
Son: Cité du cinéma- Le Caire
Montage: Youssef Malakh
Musique: Georges Kazazian
Interprétation: Youssra, Gamil Ratib, Nabil Halafaoui, Mahmoud Himida, Abdelaziz Makhioune
Production: Alix Production -Paris, Aflam Guirguis Fawzi-Le Caire, Imago Film International-Tanger
Format: 35 mm
Durée: 90 mn
Date: Tourné en 1991. Inédit
Couleur
Moumen Smihi est un metteur en scène ambitieux. Il se trouve actuellement au Caire pour réaliser un film de long métrage. Après des études de cinéma à Paris, il est l'auteur de trois longs métrages, "El Chergui" (1976), "44 ou Les Récits de la nuit" (1982) et "Caftan d'amour" qui a été présenté au Festival du Caire en 1988. L'année dernière, il a réalisé un documentaire sur le cinéma égyptien.
"J'ai essayé de faire une évaluation du cinéma égyptien", dit-il au sujet de son documentaire. Je voulais présenter un tableau de la situation actuelle, sans complaisance ni concession. Le cinéma égyptien n'est pas fait seulement de films basés sur la dan se du ventre.
"Le film de fiction que je me prépare à tourner le mois prochain, j'en ai apporté l'histoire. J'ai écrit le scénario et les dialogues avec Bachir El Dik. Pour l'instant, les acteurs pressentis sont Izzat Al Alaïli, Leïla Iloui, Mamdouh Abdelalim, Hicham Salim et Gamil Ratib.
C'est une production égyptienne, avec la participation de la société Imago Film International, du Maroc, et la société Alix Productions, de France. Le tournage aura lieu au Caire, à Alexandrie et à Louxor. Le film raconte l'itinéraire d'une femme égyptienne, depuis sa jeunesse en Haute-Egypte jusqu'à son succés d'artiste au Caire, sur une toile de fond historique qui commence dans les années soixante et se termine dans les années quatre vingt.
Je me refuse de dire qu'il y a un cinéma égyptien d'un côté, et de l'autre un cinéma marocain. Je voudrais dire qu'il y a seulement un cinéma arabe, comme il y a, depuis toujours, la littérature arabe.
Il serait très important de créer une banque de données qui regroupe toutes les idées de projets à partir du patrimoine culturel arabe. Par exemple, ce serait très intéressant d'adapter les grands récits classiques arabes, toujours inédits au cinéma, tels que "Les avares", d'Al Jahidh, "Kalila et Dimna" d'Al Moukaffa', "Bayyad et Rayyad" le roman andalous, le "Livre des morts" pharaonique, "Guilguamesh", ou encore "Les Hilaliens", grandes épopées de l'Antiquité arabe.
L'influence des satellites se fera sentir non seulement sur le cinéma arabe, mais aussi sur la culture et l'être arabes. Nous sommes
en fait encore une fois menacés. Hier, nous étions menacés par le colonialisme territoriale. Aujourd'hui, nous sommes menacés de disparition culturelle. Les antennes paraboliques sont en train de déverser sur le monde la culture des sociétés productrices des images et des sons. C'est pour cette raison qu'il faut faire créer aujourd'hui un espace arabe d'images et de sons, il y va du destin même de la culture arabe.
Ce que j'admire le plus dans le cinéma égyptien est l'existence de compétences formidables dans tous les domaines, et pas seulement dans le domaine du casting, des comédiens. Je regrette souvent que ces compétences ne soient pas tout à fait exploitées en direction des marchés internationaux.
| | Mohamed Nasr
Al Ahram
12 février 1990
Le Caire. |

Avec Matisse à Tanger
(ma'a matisse fi tangah) Scénario, réalisation, production: Moumen Smihi
Images: Robert Alzraki
Son: Jean Quenelle
Montage: Mario Graziano
Musique: Eric Satie, Arnold Schoenberg, Aaron Coplan
Costume: Driss Raïss El Fanni
Voix: Daniel Mesguish
Production: France 3-Paris, Shéhérazade Productions- Lille,
Imago Film International-Tanger.
Format: 16 mm. et vidéo
Durée: 52 mn.
Date: 1993
Couleur
Au printemps 1912, après un séjour à Moscou, Matisse s'installe à Tanger, carrefour entre l'Europe, l'Afrique et le Monde arabe, sur les conseils de ses amis Marquet, Camoin, et ceux de Gertrude Stein. Placé sous Protectorat Franco-Espagnol, le Maroc est à cette époque au goût du jour dans une France qui se passionne pour l'orientalisme, que Matisse nomme "l'orientalité".
Révélé il y a peu, notamment par Picasso et Derain, "l'art nègre" fascine le microcosme des arts, qui, dans la foulée, redécouvre Delacroix et le japonisme. C'est dans ce contexte que Matisse s'installe pour quelques mois dans l'ancien comptoir phénicien, où il est immédiatement conquis par l'exubérance de la nature, la richesse de la flore, la gentillesse des habitants, et, surtout, par la lumière douce et
diaphane.
"Lumière aurorale",comme il dit, dans laquelle il s'enveloppe corps et âme, imprégnant son oeil de mille vibrations colorées. Il en parle comme d'une authentique "révélation".
De ce séjour, qu'il renouvellera l'année suivante, datent quelque vingt tableaux, considérés comme parmi les plus importants de son oeuvre, dont "Vue de la fenêtre", "Zorah sur la terrasse", "Le café arabe", acquis par des collectionneurs russes et exceptionnellement exposés actuellement au Centre Georges-Pompidou.
C'est cette période marocaine, véritable charnière dans la vie et l'oeuvre du peintre, que retrace ici le réalisateur Moumen Smihi, qui connait fort bien Tanger puisqu'il y habite. Un document intéressant, très utile pour la compréhension de Matisse, mais quelque peu terni par le manque de vivacité du commentaire et par une "scénarisation" inutile.
Moumen Smihi illustre avec de superbes images de Tanger la période marocaine d'un Matisse fasciné par les couleurs d'une nature exubérante. Et l'art marocain a inspiré le peintre Matisse.
Un documentaire passionnant.
| | Télé-Loisirs
du 24-4-1993
Paris.
| "Avec Matisse à Tanger", film du réalisateur marocain Moumen Smihi sur le séjour du peintre à Tanger en 1912 et 1913.
Le réalisateur tangérois met en valeur toute l'influence du Maroc sur l'oeuvre de Matisse et notamment y retrouve trois constantes: le vert marocain dont Matisse ne se départira jamais, la "lumière aurorale" de Tanger, selon le peintre, qu'il recherchera partout, à Saint-Tropez comme à Nice, et enfin le goût du tissu et de la parure, des passementeries.
| | Libération
du 22-4-93
Paris. | L'exposition Matisse à Beaubourg est l'occasion pour France 3 de diffuser un film du réalisateur marocain Moumen Smihi sur le séjour de Matisse à Tanger.
On suit pas à pas Matisse dans sa recherche de "l'orientalité", on retrouve avec lui les tons et couleurs de Matisse dans la nature même de Tanger, sans oublier cette lumière limpide qui traversera par la suite toute sa peinture. 
Chroniques marocaines
(waqa'i maghribia)
Scénario, réalisation, production: Moumen Smihi
Images: Hélène Delale
Son: Christophe Folcher
Montage: Schéhérazade Saadi
Musique: Bachir Mounir, Frantz Shubert, J.S. Bach
Interprétation: Aïcha Mahmah, Tarik Jamil, Mohamed Habachi, Soumaïa Akâboune, Mohamed Timod
Production: Art Cam International- Paris, F.E.M.I.S- Paris, Imago Film International- Tanger
Format: 16 mm.
Durée: 8O mn.
Date de tournage: 1993. Inédit
Couleur
Parmi les cinéastes qui ont contribué, à la fin des années 60, à la naissance du cinéma marocain d'une radicalité esthétique sans équivalent au Maghreb, Moumen Smihi figure figure en bonne place. L'oeuvre de ce cinéaste de cinquante-cinq ans compte sept long métrages depuis El Chergui ou le silence violent (1975). Réalisé en 1993 en 16 millimètres, sans le soutien du centre du cinéma marocain, Chroniques Marocaines est inédit dans son pays et n'a pu être distribué en France que grâce à une conjuration de bonnes volontés.
Inauguré par une série de plans assez déconcertants (un panoramique sur la ville de Fès accompagné d'un chant à la gloire de la nation arabe, des femmes qui sortent d'une usine, un enfant qui menace de se jeter d'un parapet sous les yeux de sa mère affolée, une cérémonie de circoncision), le film ne se déploie vraiment qu'avec les histoires que la mère raconte à son fils pour le consoler. Une manière de le placer sous le signe mythique des origines, de l'enfance (la mère consolante), de l'homme (la circoncision comme inscription culturelle et sociale) et du cinéma (de la sortie des usines renvoyant aux frères Lumière à la vertu documentaire du cinéma moderne).
INSPIRATION A REVENDRE
La première histoire met en scène un dresseur de singe de la place Jemaa-el-Fna de Marrakech, persécuté par trois garnements. Paraissant d'abord un prétexte pour évoquer le peuple des charmeurs de serpent, la fable se teinte d'une cruauté inattendue quand les garnements tuent le singe du bateleur, détruisant son gagne-pain.
Situé à Essaouira, le deuxième sketch ne cesse de différer la rencontre amoureuse d'un jeune homme et d'une sensuelle jeune femme , qui s'ingénie à apparaître voilée à leurs rendez-vous. Sur fond de trilinguisme (français, anglais, arabe) et de références cinématographiques (Othello d'Orson Welles), ce petit film à la beauté embrumée évoque tous les rendez-vous manqués de l'amour et de l'Histoire.
C'est a contrario dans la lumière très claire de Tanger que se situe le troisième de ces contes, dans une lignée picaresque qui, partant de la Bible (Jonas), aboutit à Herman Melville et Ernest Hemingway en passant par Jean Rouch et Marcel Pagnol. Un vieux pêcheur raillé par ses compagnons de belote pour son espoir de trouver un trésor dans les entrailles d'un monstre marin finit par affronter un immense ferry blanc dont la gueule vomit des poids lourds immatriculés en Europe. L'émouvant épilogue du film, qui revient au petit garçon partant en Europe chercher son père absent, confirme la réussite d'une économie du cinéma qui, avec trois bouts de ficelle et de l'inspiration à revendre, fait de la conscience de sa pauvreté la plus grande richesse.
| | Jacques Mandelbaum
Le Monde
17-11-1999
Paris | La question de l'absence du père sert de point de départ à ces Chroniques Marocaines, où une mère esseulée avec son garçon va lui raconter trois histoires. On peut toujours ergoter, dire que c'est une manière paresseuse pour le cinéaste Moumen Smihi - révélé dans les années 70 avec son premier long métrage El Chergui ou le silence violent - de relier entre eux trois simples courts métrages. Mais on verra surtout dans ces Chroniques une référence à la tradition arabe de l'oralité, et plus précisément aux contes des Mille et une nuits.
D'ailleurs, la première histoire se déroule sur la place de Djemaa el-Fna de Marrakech, célèbre pour ses conteurs. Là, on assiste aux tracasseries infligées par des garnements vicieux à un pauvre dresseur de singe. Début quasiment documentaire, les protagonistes sont plantés dans le décor populeux de la place. Mais c'est dans la cour intérieure d'une maison perdue dans le lacis des ruelles tortueuses qu'un drame se nouera et se dénouera, dignement, sans folklore. Une fin morale et incongrue à la fois pour cet épisode, le plus fort et le mieux ancré dans la réalité locale. Les autres contes sont moins convaincants. Notamment le deuxième, situé à Essaouira, histoire abstraite de badinage amoureux.
Le troisième démarre bien, dans une ambiance à la Pagnol : sur le port de Tanger, quatre vieux marins, plus hâbleurs les uns que les autres, palabrent. L'un deux prétend qu'un trésor gît dans le ventre d'une baleine et qu'il va aller la harponner. Il s'exécute, mais à la manière de Don Quichotte s'attaquant aux moulins à vent. L'homme prend un cargo pour le cétacé. Hélas, Smihi en reste à la théorie et exprime platement ce choc terrible entre les chimères du vieil homme et la réalité du monde moderne. Mais en dépit de ses maladresses, le film apporte un peu de fraîcheur dans un paysage cinématographique où le professionnalisme et la sophistication esthético-narrative ont presque réduit à néant toute sincérité.
| | Vincent Ostria
Les Inrockuptibles
3-11-1999
Paris | In Fes, a boy, recuperating from a circumcision carried out too late due to his father's absence, is told three comforting stories by his mother. The first is a moral tale about three kids who torment a beggar and his performing monkey in Marrakech; the second a sly fable about a sophisticated and beautiful young flirt leading an admirer to a merry dance in Essaoura, where Welles, fittingly, shot Othello; the third a cautionary tale of an old Tangier fisherman determined, against all odds and advice from pals, to catch the monstrous whale he insists haunts the straits of Gibraltar. It's an odd little film, elusive, allusive, delicate, touching, and the final scenes are even more enigmatic. If it finally doesn't quite hang together, there is still plenty to intrigue and impress en route.
| | G.A.
Time Out
1-11-2000
London | 
| Le Gosse de Tanger
(El Ayel)
Producteur et monteur : Ody Roos (Imago Films International, France)
Productrice associée et création costumes : Claude Pomme
Administration de la production : Michèle Arellano
Scénario, dialogues, réalisation : Moumen Smihi
Casting : Tanane Boussif
Casting et coach : Aziz Alta
Premier assistant réalisateur : Mohamed Chrif Tribak
Régisseur général : Rachid Cheikh
Conseil costumes Naïma Senior
Chef costumier : Larbi Yacoubi
Atelier costumes : Abdelmajid Akel, Mohamed Bouchriha, Mohamed Leghdach
Chapellerie: Atelier de la Bonne Graine
Décoratrice : Fatima Alaoui Bel Hassan
Chefs opérateurs : Robert Alazraki, Abdelkrim Derkaoui, Thierry Lebigre
Assistants image : Anna Vincent, Abdelkader Sakhi
Chef électricien : Maati Kandil
Bruitage, mixage : Dominique Lambert
Prise de son : Fredi Loth, Timothée Alazraki, Mohamed Bounouara
Montage son et making of : Emmanuel Dayan
« El Ayel » a créé l'événement. Le réalisateur Moumen Smihi a créé la surprise et l'événement lors de cette 5° édition du Festival International du Film de Marrakech. Son film « El Ayel » (2005) ou « Le Gosse de Tanger » ou encore « L'enfance révoltée », se distingue par une approche inhabituelle car en totale rupture avec les modèles reproduits. Il se distingue aussi par la recherche d'une spécificité et d'une identité culturelles pleinement assumées par l'auteur qui déclare que « la diversité culturelle veut que chaque culture s'exprime en relation avec les autres cultures ». A la sortie de la première représentation du film, et à chaud, les avis étaient départagés. Ceux qui s'attendaient à retrouver un genre aux normes canoniques auquel ils sont habitués par une consommation répétée, heureuse et passive, vont être terriblement déçus, voire même perturbés dans leur tranquillité d'esprit. Fidèle à lui-même et à son image de cinéaste-intellectuel, Moumen Smihi va permettre à ceux qui conçoivent l'art en général et le cinéma en particulier comme un chantier de création ouvert et un champ d'expérimentation et de remise en question en permanente gestation, vont trouver un film à lire et à relire avec la plus grande des attentions avant de porter un jugement hâtif, précipité et déformateur. Est-il nécessaire de classer un film dans un genre préétabli et appartenant à une grille déterminée d'avance ? Pour l'auteur, il s'agit ici d'un film d'auteur, son oeuvre s'inscrit dans un processus qui remonte à son premier court-métrage. « Depuis mon premier film, « Si Moh », dit-il dans sa conférence de presse, j'ai toujours mélangé le documentaire et la fiction ». Donc nous sommes en présence d'un film documentaire-fictionnel de type autobiographique. Narré en voix-off et en grande partie par le propre voix de Moumen Smihi lui-même, « El Ayel » se meut dans un espace assez large, celui de la ville de Tanger, repeinte aux couleurs et à la mode des années 50. C'est l'époque de l'âge d'or de cette ville au Statut International. Le narrateur, omniprésent, nous retrace la destinée de ce gosse éduqué dans les préceptes de l'Islam. Un Islam bien de chez nous. Celui de la tolérance, de la coexistence pacifique et du respect des différentes religions, et même de ceux qui ne se conforment comme il faut comme il faut ou négligent d'appliquer ces préceptes. Dieu est clément et miséricordieux, il pardonne tous les péchés. L'auteur/narrateur nous présente l'enfant Mohamed-Larbi Salmi et sa famille. Son père est un Fquih, prêcheur du vendredi. Une autorité religieuse respectable et bien respectée dans tout le quartier. Même par les noms musulmans (juifs et chrétiens). Il est consulté par les uns et les autres. Il se charge même de l'éducation sexuelle de son fils et lui parle de sujets très délicats mais toujours dans la ligne tracée par les sciences religieuses. Dans le film, l'auteur préfère le terme de pasteur pour désigner la fonction du père de l'enfant. Cette notion appartient au registre culturel et religieux judéo-chrétien. Cette culture est revendiquée par Moumen Smihi. Dans sa réponse à une journaliste espagnole, lors de la conférence de presse, il explique que parmi les causes des dernières confrontations des jeunes des banlieues en France, il faut voir la résurgence de problèmes dus à la non reconnaissance de l'identité actuelle de ces jeunes. « On parle de culture judéo-chrétienne en Europe et on s'arrête là », commente-t-il. « Ma culture est judéo-chrétienne et arabe à la fois. Comme exemple de cette culture commune mais peut-être oubliée, cette couleur bleue dont le film « Le gosse de Tanger » est imprégné. Le bleu est la caractéristique du pourtour de la Méditerranée arabe. C'est le bleu du fleuve Le Nil, d'où son appellation populaire de bleu nila. Le bleu blanc est la dominante de la culture de la Méditerranée. Le choix du double prénom du personnage, Mohamed Larbi, est un choix justifié et motivé par une double appartenance, à la fois à l'Islam, référence au prophète Mouhammad et à l'arabité, connotation du prénom de Larbi. Cette double identité revendiquée par l'auteur identifie la spécificité culturelle qui, ancrée dans le local, transcende le régional vers l'universel, vers tout ce qui est commun et réciproquement partagé et partageable. Tels sont les ingrédients d'une diversité culturelle qui est le thème récurrent dans le film « El Ayel » de Moumen Smihi. | | | Ahmed El Ftouh.
Libération
Casablanca, le 15 novembre
2005. |
1° Il semblerait que le sort de votre dernier film, Le gosse de Tanger soit meilleur que celui qui a été réservé à Chroniques marocaines, le film qui n'est jamais sorti dans les salles de cinéma. Comment expliquez-vous cela ?
Je ne me l'explique pas. J'ai envoyé des cassettes aux distributeurs, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai sorti le film en France après qu'un distributeur l'ait vu par hasard au laboratoire où je faisais des travaux. Puis le film a été à l'affiche pendant des semaines dans plusieurs villes françaises. Puis des festivals, nombreux, Washington, Londres, Milan, Amman en Jordanie... Des foules l'ont vu, des correspondants de la MAP étaient présents. Chez moi, dans mon pays, rien. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi non plus mon autre film, « La Dame du Caire » a été rejeté. J'avais mis des années à le faire. J'allais méditer mon film dans le jardin de la maison de Taha Hussein, « Ramatane », au Caire ; j'en parlais à Naguib Mahfouz (je lui disais qu'il était devenu un marabout pour nos femmes, je citais ma mère qui en parlait comme ça après les infos de la télé !). Je rêvais avec mes amis Bachir Dik ou Tewfik Salah d'un nouveau cinéma arabe. Nous allions faire une grande sortie simultanée en Egypte et au Maroc, Youssra l'actrice principale se préparait à venir à Casablanca pour la Première. Et puis le film a été rejeté, condamné, je ne sais toujours pas pourquoi. Les membres de la Commission d'Aide à la Production de l'époque (1991) qui avaient pris cette décision, je les voyais dix ans après applaudir Youssra à Marrakech et je ne comprenais pas. La star était là, mais pas son film marocain (des gens disent que c'est son meilleur rôle). Mystères ! Mystères bien de chez nous, n'est-ce pas ? Il nous reste à découvrir les droits de l'homme de l'artiste, pas seulement du politique. Mais j'espère que je vais finir par montrer mes derniers films au Maroc aussi, dans mon pays aussi !
2° Le gosse de Tanger est une fiction autobiographique. Le film a été tourné dans votre ville natale, dans votre quartier. Est-ce que le film raconte aussi, d'une certaine manière, l'enfance et la vie de Moumen Smihi ?
Oui, mais romancée, transmuée par la fiction et ses sortilèges, c'est-à-dire la magie du cinéma. Mon enfance est celle d'un marocain ordinaire, rien d'héroïque qui mérite la mention. C'est le regard qu'on porte après sur son enfance, la lecture qu'on peut en faire selon la science (la sociologie, la psychanalyse, l'histoire) ou selon les sentiments (le souvenir de lumières, de musiques, de goûts et d'odeurs, de scènes et d'événements) qui font que ça mérite la mention. Sans prétention aucune je pense à de grands livres comme le célèbre « Recherche du temps perdu » de Proust ou le non moins célèbre et délicieux « David Copperfield » de Dickens. Du côté cinéma, la série Antoine Doinel de Truffaut, « Zéro de conduite » de Jean Vigo. « L'été 42 » de Robert Mulligan. L'enfance est invocation, souvenir, élans d'amour, de mots et d'images pour le temps, les êtres et les choses qui ne sont plus. C'est ça la grandeur de la littérature et de l'art, cette invocation, cette réviviscence, c'est la revanche de l'homme sur la mort. L'homme se sachant irrémédiablement seul dans l'univers, s'invente des images, des mots, des musiques, des rituels... qui sont l'abolition de cette terrible solitude, c'est tout le sens de l'art et de la culture depuis la nuit des temps.
3° Khouloud et Saïd Amil sont les acteurs principaux du film.
Ils font partie d'un ensemble de comédiens qui m'a beaucoup étonné et donné bien du plaisir à travailler avec. Je n'aurai pas pu tenir le pari de ce film, avec une production et une technologie modestes, si je n'avais pu compter sur leur long souffle. Que cela vienne des enfants non professionnels ou des acteurs chevronnés. La technique du plan séquence est très périlleuse, il faut répéter jusqu'à l'épuisement pour, paradoxalement, faire peu de prises mais fraîches et denses, et ça a marché. Le film leur doit énormément, tous. Et pas seulement les principaux. Les petits rôles aussi ont compris et beaucoup donné avec cette méthode. Il y a de ces téléscopages dans le cinéma ! Saïd Guennouni qui joue le rôle de « Saad » dans la bande des « ouled el haouma », a reproduit dans la vie l'histoire inventée du gosse de « Chroniques marocaines » : il a « brûlé ses vaisseaux », harag comme on dit, en traversant le Détroit dans une patera ; à 12-13 ans ; on est sans nouvelles de lui.
4° Vous êtes l'un des pionniers du cinéma marocain. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur votre parcours et y a-t-il des films que vous auriez aimé réalisés et que vous n'avez pu faire pour différentes raisons ?
Beaucoup de souffrances, beaucoup de joies, trouver le discours, puis chercher l'argent ; les conflits, les drames relationnels... Les grandes joies sont venues de mes parrains dans le cinéma : Henri Langlois et sa passion, « La Cinémathèque ». Jacques Tati, il m'avait offert des chutes de pellicule vierge de « Playtime », un échec commercial mais dont on dit aujourd'hui : « l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma ! ». Son regard vaincu à ce moment là, mais plein d'éternité. Jean Rouch et son amour fou de l'Afrique. A La Mostra de Venise, Suso Cecchi d'Amico, la scénariste de tous les films de Lucchino Visconti, était venue me dire que mon film « Les récits de la nuit » lui plaisait. Elle avait arraché Monica Vitti à un déjeuner au Lido pour l'entraîner voir mon film. J'étais bouleversé, j'avais tant pleuré dans ma vie à la Cinémathèque Française en voyant les films d'Antonioni, et là mes yeux étaient dans les yeux de Monica Vitti. Marie-France Pisier à Fès ; l'accueil fervent des jeunes réservé à « Caftan d'amour » au Festival de Berlin... L'exaltation de vivre et de filmer au Caire... Les campus universitaires de Los Angeles. La réaction de Renzo Rossellini, il y a peu de temps, qui voit dans mes « Chroniques marocaines » une histoire de singe à Jamaa El Fna ressemblante à celle qu'il y a dans le célèbre film de son père « India »... Ce ne sont pas des souvenirs de vieux, mais des balises pour le travail, pour le work in progress , des acquis (les biens de l'artiste), des intensités existentielles, on se dit que ça vaut le coup de beaucoup sacrifier pour ça. Quand aux projets, on en a toujours mille. Le destin, le hasard seuls limitent les possibilités de concrétisation.
5° qu'est-ce être cinéaste pour vous, aujourd'hui ? Analyser et comprendre le monde et nous dedans. Regardez les films des auteurs de cinéma de maintenant : Kenneth Loach, Pedro Almodovar, Woody Allen... A la suite des aînés, ils racontent la vie des hommes comme la littérature et la peinture l'ont fait à travers les siècles. Le cinéma est cet art nouveau qui raconte de grandes et terribles fictions où se fondent les techniques esthétiques de Dostoïevski comme du Greco, de Bach et Shubert comme de Balzac. Notre culture arabe est bien mal en point aujourd'hui, il nous faut comprendre et réagir. Damas, Bagdad, Le Caire, Fès ont été les capitales du monde civilisé un temps, un temps qui a duré des siècles. Ce n'est pas de l'arabisme stéréotypé. Marrakech a été la ville de la Première Renaissance que les Européens tardent à enseigner à l'école, avec les conséquences bouleversantes que l'on voit dans les banlieues de leurs villes. Ibn Rochd et Ibn Tofaïl, savants et artistes du règne almohade, ont les premiers, ici, en plein Moyen-âge, cultivé et prôné le retour à l'héllénisme, aux fameuses humanités gréco-latines à l'origine de notre modernité. Voilà, le réalisateur de film est un peu le visionnaire des temps nouveaux, comme Ozu le Japonais, Abraham Polonski l'Américain, Chadi Abdessalam... Sa force discursive et d'expression va considérablement s'accroître grâce aux nouvelles technologies, qui apportent indépendance et puissance de circulation des objets culturels. | | | « Le Matin »
Casablanca le 12 novembre 2005
Entretien réalisé par Khadija Alaoui. | | A la lumière de ces deux concepts, le spectateur, rendu au terme des 90 minutes de ce huitième long métrage de Smihi, ne peut s’empêcher de relever le dualisme qui soutient cette œuvre. Combinaison heureuse entre le réel et l’imaginaire, El Ayel fait place nette aussi bien au documentaire qu’à la fiction. L’histoire se situe dans les années 50 à Tanger, ville du nord du Maroc où est né le réalisateur. Si elle s’ouvre par un commentaire documenté d’images d’archives de cette époque de la « mythique zone internationale », n’est-ce pas pour mieux montrer que « celui qui se souvient est maître du temps » ? Dès cet instant, El Ayel se mue en analyse scientifique, sorte d’étude différentielle des croyances et des institutions conçues comme fondement des structures sociales. D’un côté, l’école coranique, où les rigueurs de l’éducation religieuse poussent jusqu’à l’humiliation et à la martyrisation du corps – les séances de flagellation sont publiques ; on peut y boire de l’eau sale à partir du moment où « cela est bon pour Allah » - ; et de l’autre, l’école occidentale, où on apprend non seulement que « la science est lumière et l’ignorance une bêtise », mais aussi la morale – « l’oisiveté est la mère de tous les vices ». Cet aspect du film nous rapproche de l’Aventure ambiguë de Cheikh Amidou Kane et de son hérosSamba Diallo qui, comme Larbi Salmi, subit l’éducation religieuse à l’école coranique, et fréquente l’école du « Blanc » où on apprend à « vaincre sans avoir raison ». On est alors confronté ici à la formation de la personnalité d’un individu au travers de valeurs morales fondamentalement opposées. A côté de cette recherche anthropologique, se situe la dimension psychologique du film. Pour l’illustrer, le réalisateur commence par individualiser l’un de ses personnages, Mohamed Larbi Salmi, un môme (El Ayel) de 10 ans, interprété avec beaucoup de poésie par Abdesslam Begdouri. A travers lui, il montre comment un enfant peut être troublé par ses premiers pas dans la vie, comment il peut être ballotté entre ses instincts solitaires et grégaires à la fois, entre la révolte et la soumission, entre le monde clos de sa famille ou de ses écoles (coranique et des fils de notables) et le grand vent de la rue ou des plages, entre son amour pour une femme de loin son aînée, qu’il doit partager avec celui qu’il a pour le cinéma. Sont-ce là les conséquences d’une éducation par la douceur, celle donnée à un janséniste par un père qui ne bat pas ses enfants, qui leur laisse leur chance, et qui – tout un symbole – habite la « Rue du soleil » avec sa famille qui aspire à devenir moderne ? Et concernant l’usage des symboles dans son film, Moumen Smihi use et abuse de la tonalité bleue. Si Le gosse de Tanger montre avec beaucoup d’à-propos les caractéristiques propres à l’architecture marocaine de l’époque, l’usage du bleu vient ici renforcer l’appartenance de cette couleur au nord du Maroc dont est issu Smihi. Sous l’influence de la lumière dont elle n’est pas détachable, elle accompagne la tension musculaire qui envahit par moments les différents protagonistes. Et au final, comment comprendre l’immensité de cette mer bleue, sinon comme un besoin de liberté, d’émancipation ou d’évasion, ou encore comme l’attirance de l’infini, qui sert de catharsis « à tous ceux qui sur la terre arabe crient vivent les libertés, toutes les libertés », pour reprendre les mots du réalisateur ? El Ayel , fruit entre autres de lectures de Smihi et de la rencontre à Paris entre le réalisateur et le structuralisme triomphant des décennies 70 – 80, l’a conduit « vers un cinéma où l’image s’enracine dans les sciences sociales et humaines, et dans la poésie ». Oeuvre d’auteur, il montre une société arabe écartelée entre son passé féodal, les reliques du colonialisme, le contact avec la modernité et les misères du sous-développement. Tout ceci au travers d’une « mise en scène du regard à distance, humble, ému, émerveillé, ou malheureux ». À la fois. | | | Jean-Marie MOLLO OLINGA Cameroun.
http://www.africine.com
| Si Moh | El Chergui | 44 récits | Caftan | Cinéma égyptien | La Dame | Matisse | Chroniques | Le Gosse de Tanger  | |